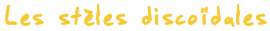
Qu'est-ce
qu'une stèle discoïdale?
 Dans nos régions, les stèles discoïdales sont des monuments funéraires
chrétiens. Elles sont
constituées d'un pied, de forme variable, surmonté d'un disque généralement
plein, le plus souvent orné sur les deux faces et taillé dans la roche locale
(grès, calcaire, ...).
Dans nos régions, les stèles discoïdales sont des monuments funéraires
chrétiens. Elles sont
constituées d'un pied, de forme variable, surmonté d'un disque généralement
plein, le plus souvent orné sur les deux faces et taillé dans la roche locale
(grès, calcaire, ...).
Plantées à la tête de la tombe, ces stèles avaient un rôle de signalisation
funéraire et par certains détails pouvaient rappeler la profession ou
l'appartenance sociale de la personne.
La croix, sous ses différentes formes (latine, grecque, ...), est le motif le
plus représenté sur le disque.
Le disque des stèles était presque au ras du sol; c'était d'ailleurs
nécessaire pour que le pied, qui est parfois assez court, soit bien enraciné
en terre et assure la bonne tenue de l'ensemble.
Apparues à l'époque médiévale, les stèles discoïdales sont, peut-être, la
survivance de traditions funéraires gallo-romaines.
Les stèles discoïdales d'Aragon :
 La
commune d'Aragon possède, à ce jour, une série de onze stèles
discoïdales, provenant probablement de l'ancien cimetière et intégrées dans le
mur de clôture (côté sud) lors d'une réfection à l'époque moderne. Grâce à leur
redécouverte par Albert Dupont il y a quelques années, ces stèles ont pu être
étudiées.
La
commune d'Aragon possède, à ce jour, une série de onze stèles
discoïdales, provenant probablement de l'ancien cimetière et intégrées dans le
mur de clôture (côté sud) lors d'une réfection à l'époque moderne. Grâce à leur
redécouverte par Albert Dupont il y a quelques années, ces stèles ont pu être
étudiées.
La municipalité a désiré les mettre en valeur en installant des reproductions
fidèles sur l'espace engazonné, aménagé, de «l'Hort del Riton » (Jardin du
Curé), en face du Prieuré et de l'église.
Grâce aux conseils et à l'aide de Jean-Claude Rivière, historien et Président de
la Fédération de la Pierre Sèche, et d'Alphonse Snoeck, sculpteur et mouleur à
Lagrasse, ce projet a pu voir le jour.
La stèle inventoriée AGN01 présente sur une face de son disque une forme
triangulaire, pointe dirigée vers le bas. Cette représentation pourrait
suggérer le fer d'un outil court, une truelle de maçon, ou le soc d'une araire,
appelée «relho». Cette stèle représente sur son autre face une croix latine,
c'est-à-dire que sa branche inférieure est sensiblement plus longue que les
autres.
La majorité des stèles de la série (de AGN02 à AGN06) porte une croix grecque
évasée ou pattée.
Cet ensemble paraît dater d'une période comprise entre le XII° et le XIV°
siècle. Elles ont été travaillées selon la technique du champlevé : le décor est
obtenu en enlevant au disque de pierre la matière nécessaire pour faire
apparaître les motifs tels que croix, bordure, ...
Une autre copie remplace la stèle qui marquait l'entrée du cimetière.
Inventoriée sous la référence AGN08, elle porte une croix latine sur une face,
un nom et une date (COMBES 1660) sur l'autre face. Sans aucune certitude,
l'hypothèse d'un remploi ne pouvant être écartée, il s'agirait d'une stèle
signalant la tombe d'un habitant d'Aragon décédé dans la seconde moitié du XVII°
siècle !
Cette stèle a été travaillée en vrai relief ; le motif apparaît totalement
dégagé du bloc d'origine et la croix ressort de près de deux centimètres du nu
du disque. On a pu reconstituer le décor d'une des faces de la stèle inventoriée
AGN07, très dégradée ; il s'agit d'une étoile à cinq branches. Ce symbole, assez
rare dans le corpus des stèles languedociennes, est à rapprocher des signes
utilisés par les confréries de maîtres maçons. Traditionnellement, l'étoile à
cinq branches est liée à la maîtrise de cet art.
Les stèles AGN10 et AGN11, retaillées, ont été utilisées comme croix de
carrefour, la première à Roquemalet (Roquemulet), la seconde près du domaine de
Cabrol.
 Retour
Retour
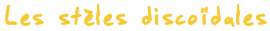
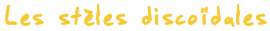
Dans nos régions, les stèles discoïdales sont des monuments funéraires
chrétiens. Elles sont
constituées d'un pied, de forme variable, surmonté d'un disque généralement
plein, le plus souvent orné sur les deux faces et taillé dans la roche locale
(grès, calcaire, ...).